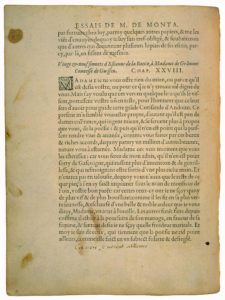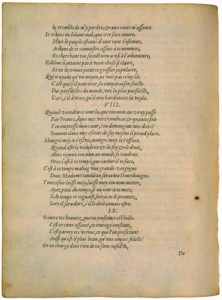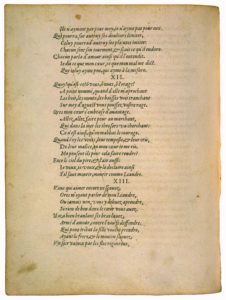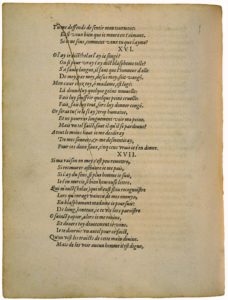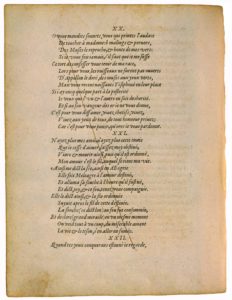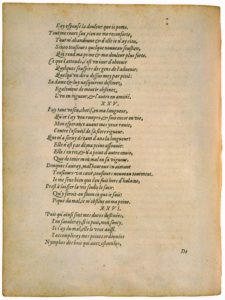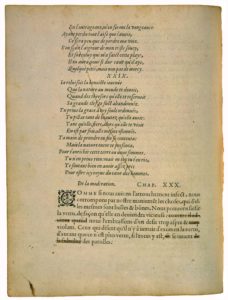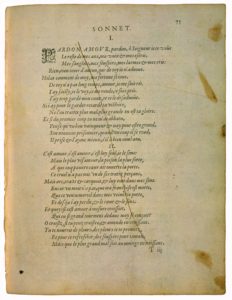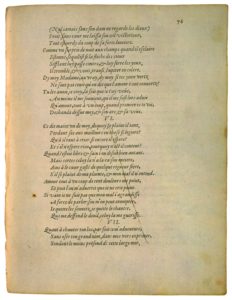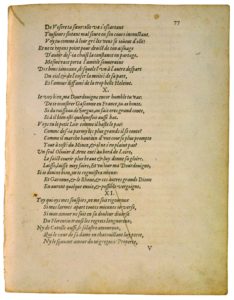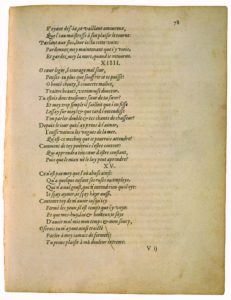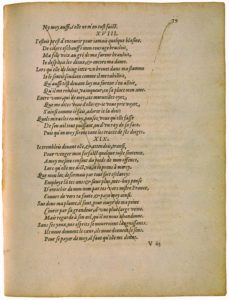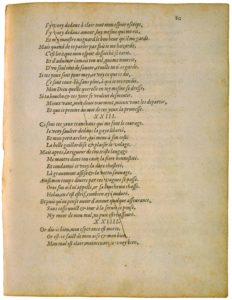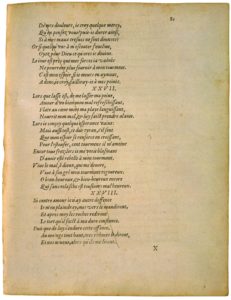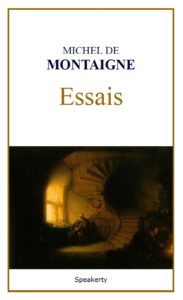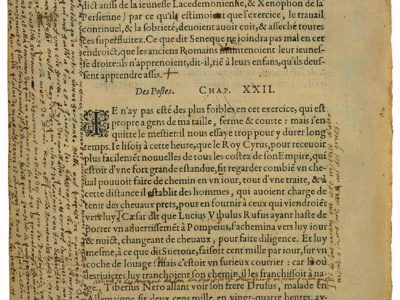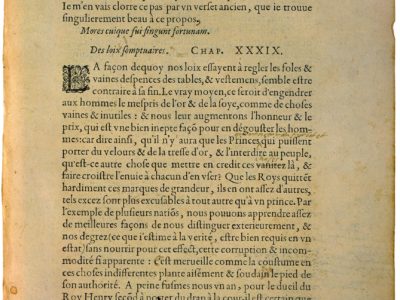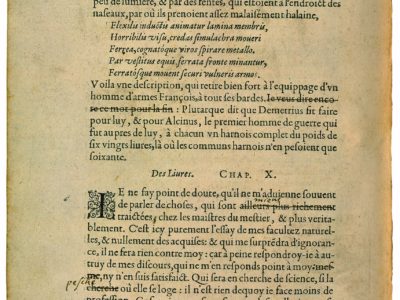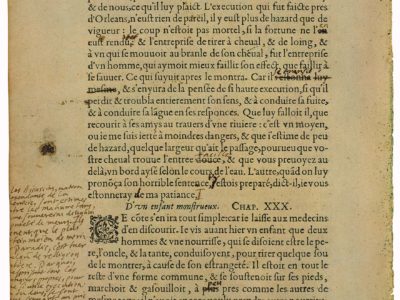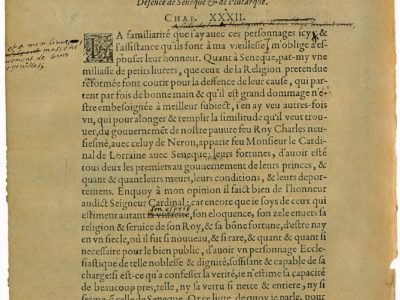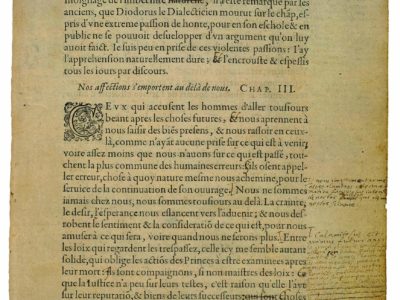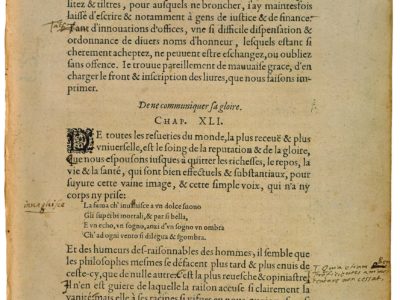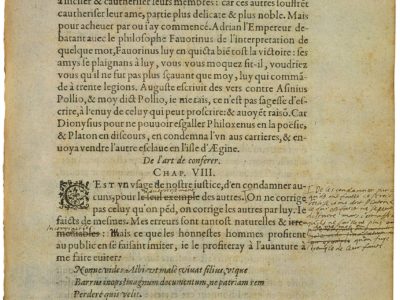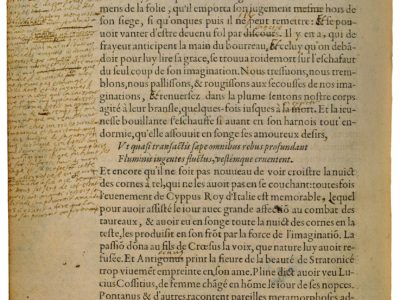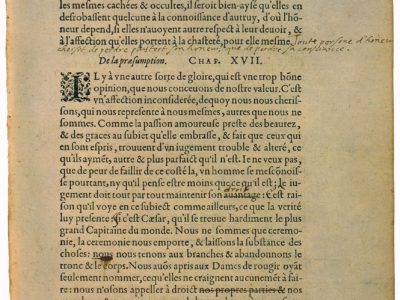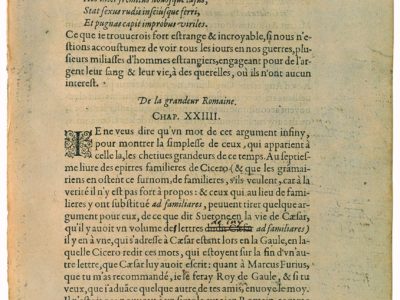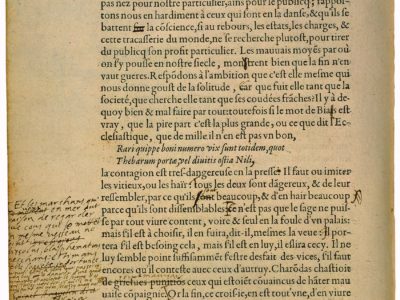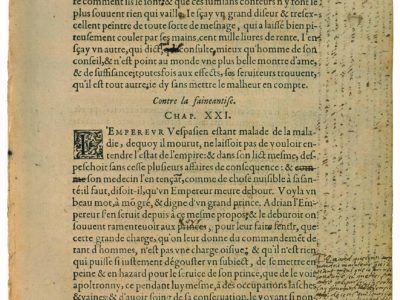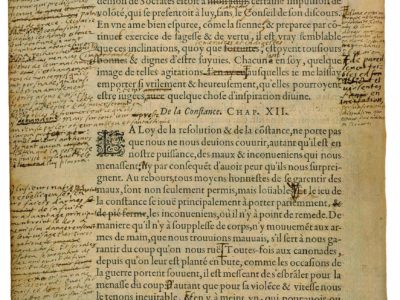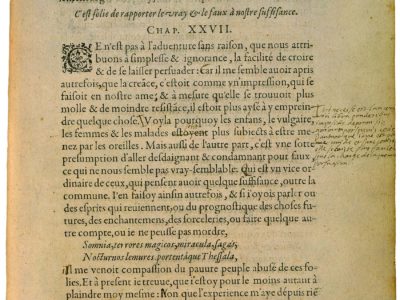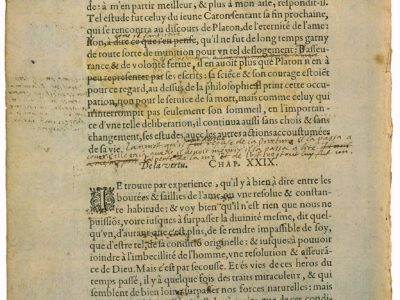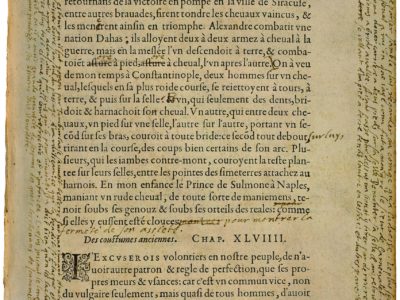Retrouvez l’essai Vingt et neuf sonnets d’Étienne de La Boetie de Michel de Montaigne extrait du recueil de philosophie Essais (Livre 1 Chapitre 29) en pdf, vidéo streaming, écoute audio, lecture libre, texte gratuit et images à télécharger.
| Auteur | Michel de Montaigne |
|---|---|
| Recueil | Les Essais de Montaigne |
| Genre | Essai |
| Courant | Humanisme |
| Siècle de parution | 16ème siècle |
La vidéo
Le texte
Livre I – Chapitre XXIX
Vingt et neuf sonnets d’Étienne de La Boetie
SONNET
I.
PARDON AMOUR, pardon, ô Seigneur je te voüe
Le reste de mes ans, ma voix et mes écris,
Mes sanglots, mes soupirs, mes larmes et mes cris :
Rien, rien tenir d’aucun, que de toi je n’aduoue.
Hélas comment de moi, ma fortune se ioue.
De toi n’a pas longtemps, amour, je me suis ris.
J’ai failli, je le vois, je me rends, je suis pris.
J’ai trop gardé mon cœur, or je le desadvoüe.
Si j’ai pour le garder retardé ta victoire,
Ne l’en traite plus mal, plus grande en est ta gloire.
Et si du premier coup tu ne m’as abattu,
Pense qu’un bon vainqueur et nay pour être grand,
Son nouveau prisonnier, quand un coup il se rend,
Il prise et l’aime mieux, s’il a bien combatu.
II.
C’est amour, c’est amour, c’est lui seul, je le sens :
Mais le plus vif amour, la poison la plus forte,
À qui onq pauvre cœur ait ouverte la porte.
Ce cruel n’a pas mis un de ses traitz perçants,
Mais arc, traits et carquoys, et lui tout dans mes sens.
Encor un mois n’a pas, que ma franchise est morte,
Que ce venin mortel dans mes veines je porte,
Et déjà j’ai perdu, et le cœur et le sens.
Et quoi ? Si cet amour à mesure croissait,
Qui en si grand tourment dedans moi se conçoit ?
Ô croistz, si tu peux croître, et amende en croissant.
Tu te nourris de pleurs, des pleurs je te prometz,
Et pour te refreschir, des soupirs pour jamais.
Mais que le plus grand mal soit au moins en naissant.
III.
C’est fait mon cœur, quitons la liberté.
De quoi meshuy servirait la défense,
Que d’agrandir et la peine et l’offense ?
Plus ne suis fort, ainsi que j’ai été.
La raison fût un temps de mon côté,
Or revoltée elle veut que je pense
Qu’il faut servir, et prendre en récompense
Qu’oncq d’un tel neud nul ne fût arrêté.
S’il se faut rendre, alors il est saison,
Quand on n’a plus devers soi la raison.
Je vois qu’amour, sans que je le deserve,
Sans aucun droit, se vient saisir de moi ?
Et vois qu’encor il faut à ce grand Roi
Quand il a tort, que la raison lui serve.
IIII.
C’était alors, quand les chaleurs passées,
Le sale Automne aux cuves va foulant,
Le raisin gras dessoubz le pied coulant,
Que mes douleurs furent encommencées.
Le paisan bat ses gerbes amassées,
Et aux caveaux ses bouillants muis roulant,
Et des fruitiers son automne croulant,
Se venge lors des peines advancées.
Serait ce point un présage donné
Que mon espoir est déjà moissonné ?
Non certes, non. Mais pour certain je pense,
J’aurai, si bien à deuiner j’entends,
Si l’on peut rien prognostiquer du temps,
Quelque grand fruit de ma longue espérance.
V.
J’ai vu ses yeux perçants, j’ai vu sa face claire :
(Nul jamais sans son dam ne regarde les dieux) ;
Froit, sans cœur me laissa son œil victorieux,
Tout estourdi du coup de sa forte lumière.
Comme un surpris de nuit, aux champs, quand il éclaire,
Étonné, se pallist si la flèche des cieux
Sifflant lui passe contre, et lui serre les yeux,
Il tremble, et voit, transi, Jupiter en colère.
Dis moi Madame, au vrai, dis moi si tes yeux vertz
Ne sont pas ceux qu’on dit que l’amour tient couvertz ?
Tu les avais, je crois, la fois que je t’ai vue,
Au moins il me souvient qu’il me fût lors avis
Qu’amour, tout à un coup, quand premier je te vis,
Desbanda dessus moi, et son arc, et sa vue.
VI.
Ce dit maint un de moi, de quoi se plaint il tant,
Perdant ses ans meilleurs en chose si legiere ?
Qu’a-t-il tant à crier, si encore il espère ?
Et s’il n’espère rien, pourquoi n’est il content ?
Quand j’étais libre et sain j’en disais bien autant.
Mais certes celui-là n’a la raison entière,
Ains a le cœur gaté de quelque rigueur fière,
S’il se plaint de ma plainte, et mon mal il n’entend.
Amour tout à un coup de cent douleurs me point,
Et puis l’on m’avertit que je ne crie point.
Si vain je ne suis pas que mon mal i’agrandisse
A force de parler : son m’en peut exempter,
Je quitte les sonnetz, je quitte le chanter.
Qui me défend le deuil, celui-là me guérisse.
VII.
Quand à chanter ton lot, parfois je m’aventure,
Sans oser ton grand nom, dans mes vers exprimer,
Sondant le moins profond de cette large mer,
Je tremble de m’y perdre, et aux rives m’assure.
Je crains, en louant mal, que je te fasse injure.
Mais le peuple étonné d’ouïr tant t’estimer,
Ardent de te connaître, essaie à te nommer,
Et cherchant ton saint nom ainsi à l’aventure,
Ébloui n’atteint pas à voir chose si claire,
Et ne te trouve point ce grossier populaire,
Qui n’ayant qu’un moyen, ne voit pas celui-là :
C’est que s’il peut trier, la comparaison faite,
Des parfaites du monde, une la plus parfaite,
Lors, s’il a voix, qu’il crie hardiment la voilà.
VIII.
Quand viendra ce jour-là, que ton nom au vrai passe
Par France dans mes vers ? combien et quantes fois
S’en empresse mon cœur, s’en démangent mes doigts ?
Souvent dans mes écrits de soi même il prend place.
Maugré moi je t’écris, malgré moi je t’efface,
Quand Astrée viendrait et la foi et le droit,
Alors joyeux ton nom au monde se rendrait.
Ores c’est à ce temps, que cacher il te fasse,
C’est à ce temps malin une grande vergogne
Donc Madame tandis tu seras ma Dordogne.
Toutefois laisse-moi, laisse-moi ton nom mettre,
Ayez pitié du temps, si au jour je te metz,
Si le temps ce connaît, lors je te le prometz,
Lors il sera doré, s’il le doit jamais être.
IX.
O entre tes beautés, que ta constance est belle.
C’est ce cœur assuré, ce courage constant,
C’est parmi tes vertus, ce que l’on prise tant :
Aussi qu’est-il plus beau, qu’une amitié fidèle ?
Or ne charge donc rien de ta sœur infidèle,
De Vézère ta sœur : elle va s’écartant
Toujours flottant mal sûre en son cours inconstant.
Vois-tu comme à leur gré les vents se jouent d’elle ?
Et ne te repens point pour droit de ton aînage
D’avoir déjà choisi la constance en partage.
Même race porta l’amitié souveraine
Des bons jumeaux, desquels l’un à l’autre départ
Du ciel et de l’enfer la moitié de sa part,
Et l’amour diffamé de la trop belle Hélène.
X.
Je vois bien, ma Dordogne encore humble tu vas :
De te montrer Gasconne en France, tu as honte.
Si du ruisseau de Sorgue, on fait ores grand conte,
Si a-t-il bien été quelquefois aussi bas.
Vois-tu le petit Loir comme il hate le pas ?
Comme déjà parmi les plus grands il se compte ?
Comme il marche hautain d’une course plus prompte
Tout à côté du Mince, et il ne s’en plaint pas ?
Un seul Olivier d’Arne enté au bord de Loire
Le fait courir plus brave et lui donne sa gloire.
Laisse, laisse-moi faire, et un jour ma Dordogne
Si je devine bien, on te connaîtra mieux :
Et Garonne, et le Rhosne, et ces autres grands Dieux
En auront quelque ennui, et possible vergogne.
XI.
Toi qui oys mes soupirs, ne me soys rigoureux
Si mes larmes à part toutes miennes je verse,
Si mon amour ne suit en sa douleur diverse
Du Florentin transi les regrets langoureux,
Ni de Catulle aussi, le folatre amoureux,
Qui le cœur de sa dame en chatouillant lui perce,
Ni le savant amour du demi-Grec Properce,
Ils n’aiment pas pour moi, je n’aime pas pour eux,
Qui pourra sur autrui ses douleurs limiter,
Celui pourra d’autrui les plaintes imiter :
Chacun sent son tourment et sait ce qu’il endure
Chacun parla d’amour ainsi qu’il l’entendit.
Je dis ce que mon cœur, ce que mon mal me dit.
Que celui aime peu, qui aime à la mesure.
XII.
Quoi ? qu’est-ce ? os vents, os nues, os l’orage !
À point nommé, quand d’elle m’approchant
Les bois, les monts, les baisses vois tranchant
Sur moi d’aguet vous poussez votre rage.
Ores mon cœur s’embrase davantage.
Allez, allez faire peur au marchand,
Qui dans la mer les trésors va cherchant :
Ce n’est ainsi, qu’on m’abat le courage.
Quand j’oys les vents, leur tempête, et leurs cris,
De leur malice, en mon cœur je me ris.
Me pensent-ils pour cela faire rendre ?
Fasse le ciel du pire, et l’air aussi :
Je veux, je veux, et le déclare ainsi
S’il faut mourir, mourir comme Léandre.
XIII
Vous qui aimer encore ne savez,
Ores m’oyant parler de mon Léandre,
Ou jamais non, vous y devez apprendre,
Si rien de bon dans le cœur vous avez,
Il osa bien branlant ses bras lavez,
Armé d’amour, contre l’eau se défendre,
Qui pour tribut la fille voulut prendre,
Ayant le frère, et le mouton sauvez.
Un soyr vaincu par les flots rigoureux,
Voyant déjà, ce vaillant amoureux,
Que l’eau maîtresse à son plaisir le tourne :
Parlant aux flots, leur jeta cette voix :
Pardonnez-moi maintenant que j’y vais,
Et gardez-moi la mort, quand je retourne.
XIV.
Ô cœur léger, os courage mal sûr,
Penses-tu plus que souffrir je te puisse ?
Ô bonté creuse, os couverte malice,
Traître beauté, venimeuse douceur.
Tu étais donc toujours sœur de ta sœur ?
Et moi trop simple il fallait que j’en fisse
L’essai sur moi ? Et que tard j’entendisse
Ton parler double et tes chants de chasseur ?
Depuis le jour que j’ai pris à t’aimer,
J’eusse vaincu les vagues de la mer.
Qu’est-ce aujourd’hui que je pourrais attendre ?
Comment de toi pourrais-je être content ?
Qui apprendra ton cœur d’être constant,
Puisque le mien ne le lui peut apprendre ?
XV.
Ce n’est pas moi que l’on abuse ainsi :
Qu’à quelque enfant ses ruses on emploie,
Qui n’a nul goût, qui n’entend rien qu’il oie :
Je sais aimer, je sais hair aussi.
Contente-toi de m’avoir jusqu’ici
Fermé les yeux, il est temps que j’y voie :
Et qu’aujourd’hui, las et honteux je soys
D’avoir mal mis mon temps et mon souci,
Oserais-tu m’ayant ainsi traité
Parler à moi jamais de fermeté ?
Tu prends plaisir à ma douleur extrême.
Tu me défends de sentir mon tourment :
Et si veux bien que je meure en t’aimant.
Si je ne sens, comment veux-tu que j’aime ?
XVI.
Oh l’ai-je dit ? Hélas l’ai-je songé ?
Ou si pour vrai j’ai dit blasphème-t-elle ?
S’a fausse langue, il faut que l’honneur d’elle
De moi, par moi, de sur moi, soyt vengé.
Mon cœur chez toi, os madame, est logé :
Là donne-lui quelque gêne nouvelle :
Fais-lui souffrir quelque peine cruelle :
Fais, fais-lui tout, fors lui donner congé.
Or seras-tu (je le sais) trop humaine,
Et ne pourras longuement voir ma peine.
Mais un tel fait, faut-il qu’il se pardonne ?
À tout le moins haut je me dédirai
De mes sonnets, et me démentirai,
Pour ces deux faux, cinq cents vrais je t’en donne.
XVII.
Si ma raison en moi s’est pu remettre,
Si recouvrer asteure je me puis,
Si j’ai du sens, si plus homme je suis,
Je t’en mercie, os bienheureuse lettre.
Qui m’eût (hélas) qui m’eût su reconnaître
Lorsqu’enragé vaincu de mes ennuis,
En blasphémant ma dame je poursuis ?
De loin, honteux, je te vis lors paraître
Ô saint papier, alors je me revins,
Et devers toi dévotement je vins.
Je te donnerais un autel pour ce fait,
Qu’on vît les traits de cette main divine.
Mais de les voir aucun homme n’est digne,
Ni moi aussi, si elle ne m’en eût fait.
XVIII.
J’étais près d’encourir pour jamais quelque blâme.
De colère échauffé mon courage brûlait,
Ma folle voix au gré de ma fureur branlait,
Je dépitais les dieux, et encore ma dame.
Lorsqu’elle de loin jette un brevet dans ma flamme
Je le sentis soudain comme il me rhabillait,
Qu’aussitôt devant lui ma fureur s’en allait,
Qu’il me rendait, vainqueur, en sa place mon âme.
Entre vous, qui de moi, ces merveilles oyez,
Que me dites-vous d’elle ? et je vous prie voyez,
S’ainsi comme je fais, adorer je la dois ?
Quels miracles en moi, pensez-vous qu’elle fasse
De son œil tout puissant, ou d’un rai de sa face.
Puisqu’en moi firent tant les traces de ses doigts.
XIX.
Je tremblais devant elle, et attendais, transi,
Pour venger mon forfoit quelque juste sentence,
À moi-même con(sci)ent du poids de mon offense,
Lorsqu’elle me dit, va, je te prends à merci.
Que mon lot désormais partout soyt éclairci :
Emploie là tes ans : et sans plus mes-hui pense
D’enrichir de mon nom par tes vers notre France,
Couvre de vers ta faute, et paye-moi ainsi.
Sus donc ma plume, il faut, pour jouir de ma peine
Courir par sa grandeur, d’une plus large vene.
Mais regarde à son œil, qu’il ne nous abandonne.
Sans ses yeux, nos esprits se mourraient languissants.
Ils nous donnent le cœur, ils nous donnent le sens.
Pour se payer de moi, il faut qu’elle me donne.
XX.
Ô vous maudits sonnets, vous qui prîtes l’audace
De toucher à ma dame : os malins et pervers,
Des Muses le reproche, et honte de mes vers :
Si je vous fis jamais, s’il faut que je me fasse
Ce tort de confesser vous tenir de ma race,
Lors pour vous les ruisseaux ne furent pas ouverts
D’Apollon le doré, des muses aux yeux verts,
Mais vous reçut naissants Tisiphone en leur place
Si j’ai oncq quelque part à la postérité
Je veux que l’un et l’autre en soyt déshérité.
Et si au feu vengeur des or je ne vous donne,
C’est pour vous diffamer, vivez, chétifs, vivez,
Vivez aux yeux de tous, de tout honneur privez :
Car c’est pour vous punir, qu’ores je vous pardonne.
XXI.
N’ayez plus mes amis, n’ayez plus cette envie
Que je cesse d’aimer, laissez-moi obstiné,
Vivre et mourir ainsi, puisqu’il est ordonné,
Mon amour c’est le fil, auquel se tient ma vie.
Ainsi me dit la fée, ainsi en Aeagrie
Elle fit Méléagre à l’amour destiné,
Et alluma sa souche à l’heure qu’il fut né,
Et dit, toi, et ce feu, tenez-vous compagnie.
Elle le dit ainsi, et la fin ordonnée
Suivit après le fil de cette destinée.
La souche (ce dit-on) au feu fut consommée,
Et dès lors (grand miracle) en un même moment,
On vit tout à un coup, du misérable amant
La vie et le tison, s’en aller en fumée.
XXII.
Quand tes yeux conquérants étonné je regarde,
J’y vois dedans au clair tout mon espoir écrit,
J’y vois dedans amour, lui-même qui me rit,
Et me montre mignard le bonheur qu’il me garde.
Mais quand de te parler parfois je me hasarde,
C’est lorsque mon espoir desséché se tarit.
Et d’avouer jamais ton œil, qui me nourrit,
D’un seul mot de faveur, cruelle, tu n’as garde.
Si tes yeux sont pour moi, or vois ce que je dis,
Ce sont ceux-là, sans plus, à qui je me rendis.
Mon Dieu quelle querelle en toi-même se dresse,
Si ta bouche et tes yeux se veulent démentir.
Mieux vaut, mon doux tourment, mieux vaut les départir,
Et que je prenne au mot de tes yeux la promesse.
XXIII.
Ce sont tes yeux tranchants qui me font le courage.
Je vois sauter dedans la gaie liberté,
Et mon petit archer, qui mène à son côté
La belle gaillardise et plaisir le volage.
Mais après, la rigueur de ton triste langage
Me montre dans ton cœur la fière honnêteté.
Et condamné je vois la dure chasteté,
Là gravement assise et la vertu sauvage,
Ainsi mon temps divers par ces vagues se passe.
Ores son œil m’appelle, or sa bouche me chasse.
Hélas, en cet estrif, combien ai-je enduré.
Et puisqu’on pense avoir d’amour quelque assurance,
Sans cesse nuit et jour à la servir je pense,
Ni encor de mon mal, ne puis être assuré.
XXIV.
Or dis-je bien, mon espérance est morte.
Or est-ce fait de mon aise et mon bien.
Mon mal est clair : maintenant je vois bien,
Tout m’abandonne et d’elle je n’ai rien,
Sinon toujours quelque nouveau soutien,
Qui rend ma peine et ma douleur plus fortes.
Ce que j’attends, c’est un jour d’obtenir
Quelques soupirs des gens de l’avenir ;
Quelqu’un dira dessus moi par pitié :
Sa dame et lui naquirent destinez,
Également de mourir obstinez,
L’un en rigueur, et l’autre en amitié.
XXV.
J’ai tant vécu, chétif, en ma langueur,
Qu’or j’ai vu rompre, et suis encore en vie,
Mon espérance avant mes yeux ravie,
Contre l’écueil de sa fière rigueur.
Que m’a servi de tant d’ans la longueur ?
Elle n’est pas de ma peine assouvie :
Elle s’en rit, et n’a point d’autre envie,
Que de tenir mon mal en sa vigueur.
Donc j’aurai, malheureux en aimant
Toujours un cœur, toujours nouveau tourment.
Je me sens bien que j’en suis hors d’haleine,
Prêt à laisser la vie sous le faix :
Qu’y ferait-on sinon ce que je fais ?
Piqué du mal, je m’obstine en ma peine.
XXVI.
Puisqu’ainsi sont mes dures destinées,
J’en soûlerai, si je puis, mon souci.
Si j’ai du mal, elle le veut aussi.
J’accomplirai mes peines ordonnées
Nymphes des bois qui avez étonnées,
De mes douleurs, je crois quelque merci,
Qu’en pensez-vous ? puis-je durer ainsi,
Si à mes maux tresves ne sont données ?
Or si quelqu’une à m’écouter s’incline,
Oyez pour Dieu ce qu’ores je devine.
Le jour est près que mes forces jà vaines
Ne pourront plus fournir à mon tourment.
C’est mon espoir, si je meurs en aimant,
Adonc, je crois, faillirai-je à mes peines.
XXVII.
Lorsque lasse est, de me lasser ma peine,
Amour d’un bien mon mal rafraîchissant,
Flatte au cœur mort ma plaie languissant,
Nourrit mon mal, et lui fait prendre haleine.
Lors je conçois quelque espérance vaine :
Mais aussitôt, ce dur tyran, s’il sent
Que mon espoir se renforce en croissant,
Pour l’étouffer, cent tourments il m’amène
Encor tous frais : lors je me vois blamant
D’avoir été rebelle à mon tourment.
Vive le mal, os dieux, qui me dévore,
Vive à son gré mon tourment rigoureux.
Ô bienheureux et bienheureux encore
Qui sans relache est toujours malheureux.
XXVIII.
Si contre amour je n’ai autre défense
Je m’en plaindrai, mes vers le maudiront,
Et après moi les roches rediront
Le tort qu’il fait à ma dure constance.
Puisque de lui j’endure cette offense.
Au moins tout haut, mes rythmes le diront,
Et nos neveux, alors qu’ils me liront,
En l’outrageant, m’en feront la vengeance.
Ayant perdu tout l’aise que j’avais,
Ce sera peu que de perdre ma voix.
S’on sait l’aigreur de mon triste souci,
Et sur celui qui m’a fait cette plaie,
Il en aura, pour si dur cœur qu’il ait,
Quelque pitié, mais non pas de merci.
XXIX.
Jà reluysçait la benoîte journée
Que la nature au monde te devait,
Quand des trésors qu’elle te réservait
Sa grande clé, te fut abandonnée.
Tu pris la grâce à toi seule ordonnée,
Tu pillas tant de beautés qu’elle avait :
Tant qu’elle, fière, alors qu’elle te voit
En est parfois, elle-même étonnée.
Ta main de prendre enfin se contenta :
Mais la nature encor te présenta,
Pour t’enrichir cette terre où nous sommes.
Tu n’en pris rien : mais en toi tu t’en ris,
Te sentant bien en avoir assez pris
Pour être ici reine du cœur des hommes.
Michel de Montaigne, Essais